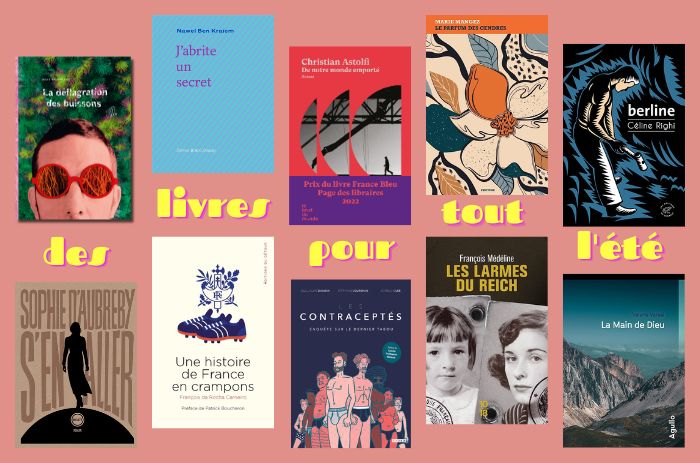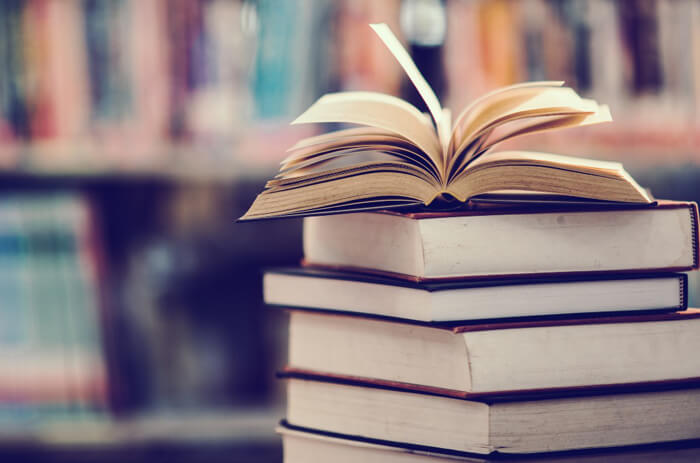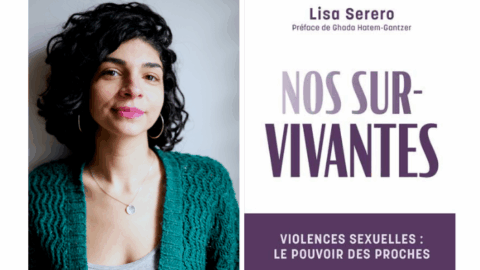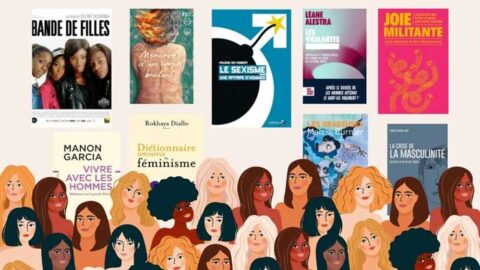Houssainatou Bah (Enedis), Isabelle Combastel (EDF) et Lucie Roudier (RTE) témoignent des conditions dans lesquelles elles ont réussi à évoluer dans un milieu scientifique et technique. © DR, EDF
À l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science, le 11 février, trois professionnelles issues de milieux scientifiques et techniques – et qui travaillent dans les Industries électriques et gazières – témoignent de leur parcours. Trouver sa place, la prendre… lorsqu’on est une femme, rien n’est jamais aisé ou acquis.
Qu’ont en commun une jeune développeuse d’Enedis, une femme issue de la recherche travaillant à RTE et une directrice du développement territorial d’EDF ? Chacune, à sa manière, a dû faire sa place dans un monde définitivement patriarcal, où les filles sont bien souvent cantonnées aux métiers du soin tandis que les garçons peuvent se rêver astronautes.
Comment évoluer dans le monde scientifique et technique ? Comment trouver sa légitimité ? Houssainatou, Isabelle et Lucie dévoilent leur parcours singulier, parfois semé d’embûches mais définitivement inspirant. De quoi donner des idées aux nouvelles générations…
« À un moment, j’ai commencé à douter de mes compétences et à me demander si j’avais vraiment ma place, si j’étais réellement légitime. »
Houssainatou Bah, conceptrice développeuse à Enedis (Courbevoie)
Embauchée en 2022 à la DSI d’Enedis, à tout juste 26 ans, Houssainatou Bah est la seule conceptrice développeuse interne de sa grande équipe. Depuis deux ans, elle travaille sur une application qui permet d’acheter de l’énergie sur les différents marchés nationaux ou internationaux afin de compenser les potentielles pertes d’électricité que subit Enedis. Elle est aussi référente technique et scrum master (référente de la méthode agile « scrum », qui permet d’améliorer la productivité d’une équipe en gestion de projet). Malgré ses nombreuses responsabilités, elle souffrait jusqu’à peu du syndrome de l’imposteur.
« Pendant mon alternance [2020-2022] on me demandait sans cesse : “Mais pourquoi tu fais de l’informatique ? Tu devrais faire de la communication.” À un moment, j’ai commencé à douter de mes compétences et à me demander si j’avais vraiment ma place, si j’étais réellement légitime. »
Lorsqu’elle postule à la DSI, elle réalise que, durant tout le processus de recrutement, elle ne rencontre que des femmes et, qui plus est, des femmes qui ont le même parcours qu’elle. Rassurée d’avoir déjà des role models, elle persévère… et décroche le poste.
Selon l’Insee, en 2019, seulement 18 % des ingénieurs en informatique sont des femmes. Pour Houssainatou, si on veut contrer ces chiffres, il faut changer la mentalité des gens et cela doit commencer dans la famille et à l’école : « Si je devais prodiguer un conseil aux jeunes femmes pour qu’elles se lancent, ce serait : faites-vous confiance, donnez tout, n’écoutez pas forcément tout ce qu’on dit, et foncez ! La seule limite qui puisse exister, c’est celle qu’on se fixe à soi-même. »
Ainsi, elle intervient régulièrement au sein de l’association Girls Can Code! pour sensibiliser les jeunes filles à l’informatique et leur montrer qu’une autre voie est possible. Dès l’âge de 9 ans, elles réalisent qu’elles peuvent envisager une carrière, poser des questions et se projeter.
« On a besoin de montrer qu’être femme, faire des sciences ou de la technique, ou être dirigeante, c’est compatible avec la société telle qu’elle est aujourd’hui. »
Isabelle Combastel, directrice du développement territorial Bretagne EDF
Isabelle Combastel débute sa carrière en 1990, au sein d’un laboratoire de recherche chez Gaz de France. Ce qui lui plaît, c’est la science appliquée, l’aspect pragmatique des choses, le fait d’arriver à penser ce qu’elle fait. Elle est la première femme à entrer dans le service. Cela signifie, entre autres, qu’il n’y a pas de chaussures de sécurité disponibles en pointure 37 et qu’il faut accomplir des tâches physiques qu’une femme a du mal à effectuer, surtout sans équipement.
Elle prend les problèmes à bras-le-corps, un par un : les chaussures de sécurité, elle en réclame à sa hiérarchie. Quant aux tâches exigeantes sur le plan physique, c’est en s’aidant de chariots qu’elle les effectuera. Cette anecdote pose la question du regard porté sur les hommes. Dans l’esprit collectif, l’homme est fort : impossible alors pour lui de se plaindre d’un mal de dos lié à de mauvaises postures de travail. L’arrivée d’une femme au sein de l’équipe a permis de réévaluer ces stéréotypes.
En 1995, Isabelle rentre à EDF au service commercial. Après avoir occupé différents postes, elle accompagne les entreprises et les territoires pour les aider à réussir la transition énergétique grâce à l’électricité bas carbone. Trente ans plus tard, Isabelle Combastel peut témoigner de l’évolution de la position des femmes au sein du monde professionnel : elles sont présentes à des postes à responsabilité, que ce soit dans l’expertise technique ou au sein des filiales comme Dalkia.
Cette entreprise remet tous les ans le prix Women’s Energy In Transition à celles qui ont un parcours inspirant, afin de renforcer la visibilité des femmes dans les métiers techniques et scientifiques. En 2019, Isabelle Combastel est lauréate de ce prix aux côtés de cinq autres femmes, étudiantes ou professionnelles en activité. En parallèle de son métier, elle est aussi co-ambassadrice pour la Bretagne d’ « Énergies Mixité ! », une communauté d’EDF qui regroupe plus de 5 000 membres et dans laquelle elle fait du mentorat.
« Les femmes doivent prendre leur place, leur voix doit être entendue. »
Pour Isabelle Combastel, il y a un réel besoin d’occuper l’espace, qu’il soit physique ou social. Membre du Conseil de développement de la métropole de Rennes, elle intervient pour EDF et comme citoyenne. Les missions du Codev sont de réfléchir sur les politiques de la métropole et de porter le regard de la société civile sur celles-ci. « Lorsqu’on prend des décisions pour organiser la ville, on s’engage parfois pour trente ans, raconte Isabelle. Les femmes doivent prendre leur place, leur voix doit être entendue car, si on ne laisse faire la cité que par et pour des hommes, nous n’y arriverons pas. »
Selon elle, les garçons ont moins besoin d’encouragement car ils vivent dans un monde qui est pensé pour eux : « On a besoin de trouver notre place, de valoriser nos talents et de montrer qu’être femme, faire des sciences ou de la technique, ou être dirigeante, c’est compatible avec la société telle qu’elle est aujourd’hui. En ce sens, les rôles modèles sont extrêmement importants : Claudie Haigneré, Simone Veil, Marie Curie et toutes celles qu’on ne connaît pas, qui ont dû publier des livres sous le nom de leur mari, qui se font fait voler leurs travaux par leur patron ou leur collègue… Il faut nous rendre notre histoire pour qu’on puisse écrire notre avenir et passer le relais. »
« Je ne suis pas sûre que mes collègues chercheurs aient autant réfléchi à la posture à adopter pour être pris au sérieux. »
Lucie Roudier, géographe et géopolitologue au sein de RTE
Dès 2015 et durant huit ans, Lucie Roudier prépare un doctorat à l’université Paris 8 sur « la création des ouvrages majeurs de transport d’électricité entre contestation et concertation : une analyse géopolitique ». Souhaitant effectuer sa recherche au sein d’une structure d’accueil, elle obtient un contrat Cifre (le dispositif des conventions industrielles de formation par la recherche) de trois ans chez RTE.
Elle travaille alors sur les lignes électriques, objet dont on parle peu, RTE étant un acteur des IEG encore relativement méconnu du grand public. Il s’agit de construire de nouvelles lignes électriques afin de raccorder des lieux de production, avec une architecture réseau vouée à évoluer. Passé une longue phase d’acculturation où il lui faut comprendre les enjeux économiques et environnementaux et choisir son terrain d’étude, Lucie Roudier identifie les acteurs, réalise des entretiens et mène un long travail de terrain, entre le nord de la France, le Cotentin, l’Aveyron et le Québec, avant de faire des préconisations pour RTE.
Sa thèse est alors financée à 50% par l’entreprise, et Lucie est rattachée à la R&D. Mais, au quotidien, elle est au département concertation et environnement à Paris-la Défense. À seulement 24 ans, elle est la seule chercheuse en sciences humaines et sociales. Bien accueillie, elle se heurte toutefois à des réticences, qui l’obligent à justifier de sa légitimité. Lorsqu’elle fait du terrain, au sein des groupements de maintenance, certains sont en effet surpris qu’elle porte seule des sujets aussi colossaux et craignent qu’elle s’effondre. Elle élabore alors une stratégie vis-à-vis de ses interlocuteurs :
« Je me suis appuyée sur mon parcours – le lycée agricole, mes grands-parents qui étaient ouvriers agricoles, ma mission d’un an chez les carriers au fin fond de la France – pour leur dire que je n’étais pas uniquement une petite chercheuse parisienne mais que j’avais un ancrage local. Si on posait la question à mes collègues chercheurs masculins de la posture à adopter pour être pris au sérieux, je ne suis pas sûre qu’ils y auraient autant réfléchi. »
Lucie Roudier, dans une démarche réflexive permanente, met depuis trois ans ses compétences au profit de la société de conseil Adoc Mètis. En plus de formations à l’intégrité scientifique et à la méthodologie de la recherche, elle mène des ateliers sur les questions de politique d’égalité femme-homme dans les écoles doctorales : « C’est une manière pour moi d’essayer d’œuvrer. J’avais envie de partager ce que j’ai acquis. »
Tags: À la une Égalité femmes hommes Portrait