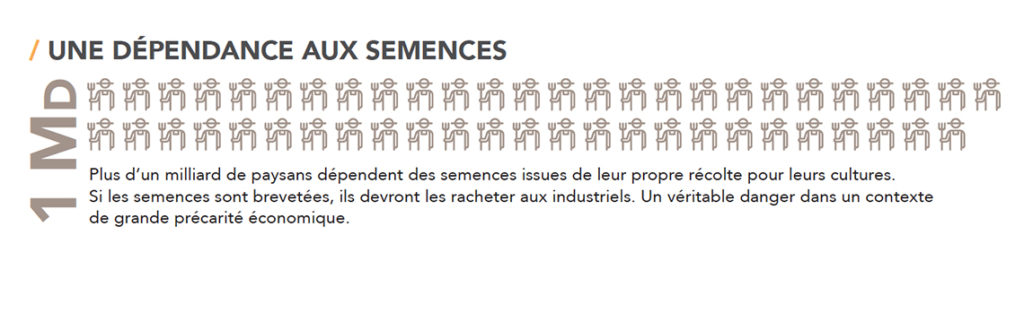Essentielles à la préservation de la biodiversité, les semences n’ont pas toutes le même statut juridique lorsqu’il s’agit de leur commercialisation. ©Elodie Jablonski/CCAS
Un nombre croissant de paysans se voit privé du droit d’accès libre aux semences au profit de puissantes multinationales. Associations et particuliers alertent sur le danger de la privatisation du vivant.
« En six mois, nous avons engrangé une trentaine de variétés : blés anciens, luzerne, courges, potimarrons, et même du piment d’Espelette… », énumère Anne-Marie Saignol, en charge de la grainothèque de Sainte-Sigolène (Haute-Loire). Ouverte en avril dernier dans les locaux de la médiathèque municipale, elle permet à chacun de prendre, déposer, échanger des graines de légumes, fruits ou fleurs.
Un espace de troc aux heures d’ouverture
« Les médiathèques comme les grainothèques sont impliquées dans la transmission du patrimoine vivant. » En France, quelque 500 grainothèques s’inscrivent désormais dans la mouvance des associations, organisations ou particuliers qui entendent lutter contre la disparition de ces petites graines, à la base de notre alimentation. Semées, récoltées, sélectionnées et échangées librement par les paysans pendant 12 000 ans, leur « confiscation » a démarré dans les années 1950. On demande alors à ceux qui cultivent la terre d’augmenter leur production et la recherche va les y aider. Pendant des décennies, les variétés végétales sont testées et croisées, parfois même entre espèces, en fonction de critères de rendement, de conservation, de résistance au transport ou d’esthétique. Ainsi naissent notamment les hybrides F1, des variétés dites à haut potentiel, mais dont le rendement élevé dépend essentiellement de l’apport d’intrants externes, c’est-à-dire d’engrais et de pesticides.
Des semences non reproductibles
Faisant le jeu des géants du marché, la loi (en Europe et dans de nombreux pays) interdit pendant des années les ventes ou échanges entre agriculteurs (depuis 2016, la nouvelle loi biodiversité permet l’échange de semences n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale dans le cadre de l’entraide entre paysans) et n’autorise que la commercialisation des semences inscrites dans le catalogue. Pour y figurer, elles doivent être conformes aux critères DHS (distinction, homogénéité, stabilité). « Des critères qui excluent par nature les semences paysannes qui sont des mélanges de plantes (ou populations) relativement proches, mais présentant une certaine diversité génétique, souligne le rapport de la coordination Solidarité urgence développement (SUD) qui rassemble plus de 170 ONG dans le monde. Mais c’est justement cette hétérogénéité qui leur donne leur capacité d’adaptation à la diversité des terroirs, aux changements climatiques, sans recours systématique à des intrants chimiques. » Au prix de la destruction des écosystèmes, le système rapporte gros aux trois grandes entreprises – DuPont-Dow, Syngenta-ChemChina et Bayer-Monsanto – qui commercialisent 53 % des semences certifiées dans le monde. D’autant que les hybrides renferment des verrous biologiques qui les rendent quasi non reproductibles. Un marché captif total : il faut en racheter tous les ans.
Un phénomène mondial
Cette prétendue révolution verte a touché le monde entier, et massivement remplacé la diversité dans les champs cultivés en Inde, en Afrique et ailleurs. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), « 75 % de la biodiversité cultivée a été perdue au cours des cinquante dernières années ». Depuis 1983, la FAO affirme que pour arrêter « la mutilation de ce patrimoine inestimable, il convient de prendre d’urgence des mesures à l’échelon local, national et international ».
Pourtant, les vieilles semences peuvent encore faire des miracles. Il suffit, par exemple, de se rendre au Conservatoire de la tomate à Lodève, près de Montpellier. Sur un sol sec et caillouteux, avec seulement deux centimètres d’humus, l’agriculteur Pascal Poot cultive ses variétés de fruits et légumes, depuis treize ans, « sans la moindre goutte d’eau (excepté de pluie) ni aucun traitement, pour des rendements très honorables. Les parasites sont rares, explique-t-il, et en cas de maladies, les plantes qui survivent transmettent leurs gènes à leurs descendantes. Ainsi peu à peu les plantes développent leur propre résistance ». Les chercheurs s’intéressent de près à ses méthodes (expliquées sur son site) et à ses récoltes. Leurs études menées en plein champ montrent que les variétés hybrides contiennent cinq à douze fois moins de nutriments (vitamines, minéraux…) que les variétés paysannes qu’il cultive. Sans parler du goût… Ce n’est qu’un exemple.
Des organisations comme Réseau Semences paysannes (lire notre entretien ci-après) ou No Patents on Seeds (Pas de brevets sur les semences) tentent d’alerter l’opinion publique et les politiques sur les impacts des brevets sur les plantes. Pour No Patents on Seeds, « ces brevets créent de nouvelles dépendances pour les agriculteurs, les sélectionneurs, les entreprises agroalimentaires et les consommateurs ». Ces organisations demandent une réglementation claire excluant « les plantes, les animaux, le matériel génétique, les procédés de sélection des plantes et des animaux, ainsi que les aliments qui en dérivent, de toute brevetabilité ». Contrairement aux semences industrielles, les semences paysannes ne sont pas protégées par des droits de propriété industrielle. Elles résultent pourtant de savoir-faire précieux.
« Il s’agit d’un accaparement totalitaire du vivant inacceptable »
Parole d’expert : Patrick de Kochko, coordinateur du Réseau semence paysannes
« La propriété intellectuelle sur le vivant (le COV ou ‘certificat d’obtention végétale’) s’est développée dans les années 1960 par le biais des industriels de la semence. Ce droit s’est durci dans le temps à tel point qu’il empêche les agriculteurs de ressemer une partie de leur récolte l’année d’après. Il est encore possible de le faire pour certaines espèces dérogatoires (céréales, fourragères, soja) en payant des royalties aux industriels de la semence détenteurs du COV, mais pour d’autres, comme les potagères, c’est interdit. Il y a globalement deux types de semences au catalogue : les hybrides F1 (dégénérescentes, il n’y a donc pas d’intérêt à les ressemer) et les ‘lignées pures’ qui, elles, peuvent être ressemées. Ainsi, en France aujourd’hui, 50 % des cultures de blé sont ressemées d’année en année par des agriculteurs qui payent donc des royalties. On appelle cela la contribution volontaire obligatoire (CVO).
Il n’existe pas à proprement parler de brevet sur les variétés dans la loi française, mais il est possible de breveter une partie du génome d’une plante. Il suffit d’identifier le caractère lié à ces gènes, comme par exemple la résistance aux pucerons d’une salade, pour déposer un brevet. Et de revendiquer des droits sur toutes les variétés qui possèdent cette séquence génétique et expriment ce caractère. Un paysan qui cultive des variétés qui contiennent naturellement ces caractères devra alors payer des droits pour continuer à le faire. Il s’agit d’un accaparement totalitaire du vivant inacceptable. Au Canada et aux États-Unis, les paysans sont poursuivis en justice par des détenteurs de brevets alors qu’ils se sont contentés de semer les graines qu’ils utilisent depuis toujours. »
Tags: Environnement Travail