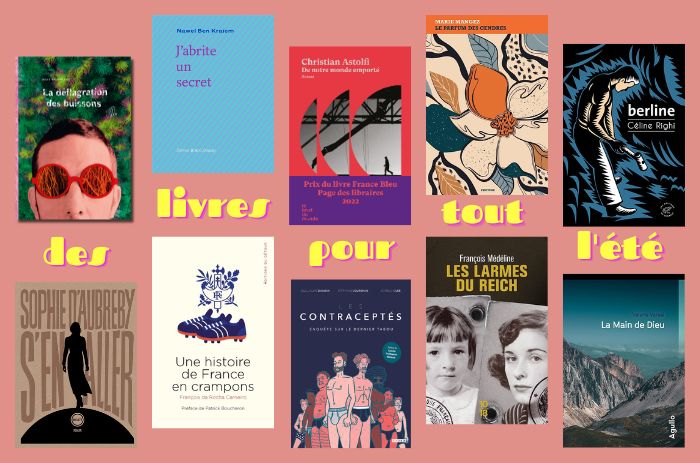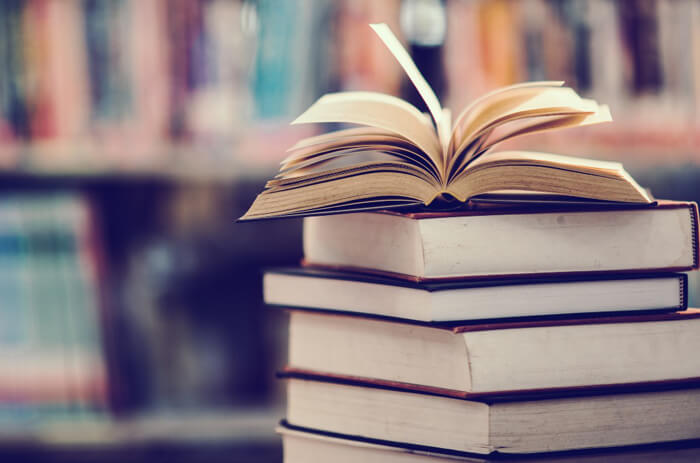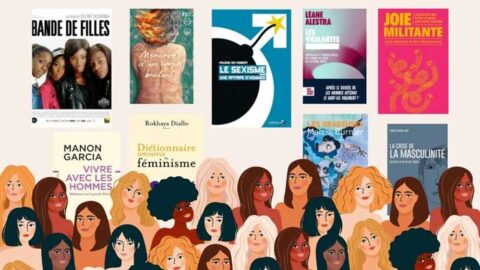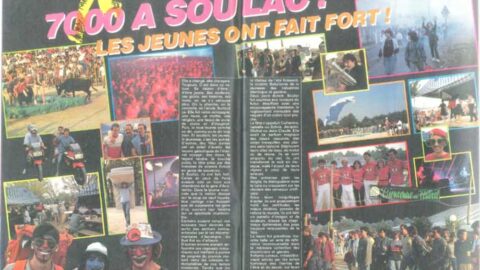De son parcours de journaliste en pleine révolution tunisienne, à ses premiers films documentaires, puis fictionnels mais tournés avec des acteurs non professionnels, découvrez la réalisatrice et productrice Erige Sehiri, marraine de Visions Sociales cette année. Elle y présentera notamment son dernier long métrage, « Promis le ciel », sélectionné au Festival de Cannes.
« Mes films sont ancrés dans un contexte social et politique »
Dans un entretien intimiste, Erige Sehiri se livre sur son parcours, ses inspirations et ses combats.
Erige Sehiri : un parcours atypique
- Née à Lyon en 1982, Erige Sehiri est une réalisatrice et productrice franco-tunisienne. Très jeune, elle se passionne déjà pour le cinéma, mais ses origines modestes l’empêchent de le considérer comme un « métier sérieux ».
- Après son baccalauréat, elle part en Amérique du Nord pour apprendre l’anglais et se former à la finance, avant de revenir en France et tourner ses premières images dans son quartier d’origine, les Minguettes.
- Devenue par la suite journaliste, en 2011 elle se rend à Tunis pour couvrir la révolution qui vient d’éclater.
- En 2012, elle tourne son premier court métrage intitulé « Le Facebook de mon père », tout en continuant sa carrière dans les médias. Très impliquée dans la mise en place d’une information libre au sein de la jeune démocratie tunisienne, elle fonde en 2013 « Inkyfada », sorte de Médiapart tunisien.
- C’est au cours de l’année 2018 qu’elle tourne son premier documentaire, « La voie normale », qui explore le quotidien des cheminots tunisiens. Le cinéma devient alors un « mode de vie, une façon de voir le monde ».
- Elle cofonde en 2020 « Rawiyat-Sisters in Film », un collectif de femmes cinéastes du monde arabe, avant de présenter un long métrage de fiction, « Sous les figues », en première mondiale au Festival de Cannes et à Visions Sociales en 2022.
- Son dernier film « Promis le ciel », avec Aïssa Maïga, marraine de Visions Sociales en 2022, est en sélection officielle à Cannes cette année.
« La voie normale », au coeur de la lutte des cheminots tunisiens
La corporation des cheminots, comme celle du personnel agricole, souvent invisibilisée et dévalorisée, est pourtant essentielle au fonctionnement d’une société. Erige Sehiri met également en lumière la beauté des gestes du travail, travail dans lequel « il y a toujours une certaine poésie, même lorsqu’il est difficile ».
Métaphore de la Tunisie elle-même et du quotidien de ses habitants, cette voie ferrée est « appelée « voie normale » par opposition à « la voie métrique », toutes deux définies par les normes internationales « d’écartement des rails ». Or « elle n’a absolument rien de normal » : tout y est défaillant, et source de multiples accidents. Les cheminots qui tentent de l’entretenir, sont confrontés à un quotidien tellement difficile que seule une bonne dose d’humour peut leur permettre de prendre du recul pour le supporter.
Tout comme son second long métrage « Sous les figues », « La Voie normale » explore le monde du travail et ses différents aspects. Le film nous plonge dans l’univers des cheminots tunisiens, en lutte contre les défaillances de la compagnie ferroviaire nationale.
Au-delà même de l’exercice de leur métier, les cheminots font preuve d’un véritable engagement pour le service public. La transmission de leur savoir est pour eux une valeur essentielle, presque « spirituelle ». Véritable lanceur d’alerte, l’un des personnages va jusqu’à se faire licencier et perdre sa femme pour dénoncer les défaillances de la compagnie qui mettent en danger de mort les voyageurs.
Une expression entre fiction, journalisme et documentaire
Le premier écran de cinéma de la jeune réalisatrice a d’abord été « la fenêtre de sa chambre » dans son petit immeuble du quartier des Minguettes à Vénissieux, lorsqu’elle était enfant. L’observation de la vie de son quartier lui offre ses premiers scénarios, et ses premières fictions : « J’y voyais les histoires possibles, ou à inventer, parce qu’on peut observer des scènes sans entendre les dialogues. C’est là que la rêverie commence, que l’imaginaire se développe ». Son cinéma de quartier lui fera pat la suite découvrir « Le Grand Bleu » de Luc Besson, « L’Esquive » d’Abdelatif Kechiche, ou « Titanic », de James Cameron.
Son premier métier – le journalisme – lui permettra également de raconter le monde. Mais fiction, journalisme et documentaire sont pour elle trois formes d’expression bien différentes : « Le journalisme ne permet pas vraiment de décrire le réel, c’est pour cela que je l’ai quitté. Pour moi, il est fondamental de montrer des personnes ou des communautés qui sont stigmatisées par de nombreux médias ». Selon elle, le cinéma permet de le faire autrement et de souligner le caractère universel de leurs histoires : « Certains spectateurs m’ont dit par exemple : ‘C’est très beau, ce film qui se passe sous les figuiers en Iran’, ignorant que l’action se déroulait en Tunisie ! »
« La fiction offre plus de liberté, mais le documentaire propose des histoires bien plus fortes. Et il permet une certaine forme de recherche, d’expérimentation. Et cette approche peut elle-même nourrir la fiction, qui s’inspire alors de la vie des gens [que l’on rencontre] ».
Ainsi, elle a pu écrire le scénario et les dialogues de « Sous les figues » en s’inspirant de la vie de ses acteurs : le choix de comédiens non professionnels, qui vivaient et travaillaient dans une région rurale de la Tunisie, lui a permis de faire entendre des dialectes qui sont peu présents dans le cinéma tunisien professionnel. Il s’agissait également pour elle de leur offrir « un véritable espace d’expression, comme sur une scène de théâtre, espace dont ils ne disposent pas dans la société ».
En résumé, indique-t-elle, « la fiction offre plus de liberté, mais le documentaire propose des histoires bien plus fortes. Et il permet une certaine forme de recherche, d’expérimentation. Et cette approche peut elle-même nourrir la fiction, qui s’inspire alors de la vie des gens [que l’on rencontre] ».
Un autre regard sur la Tunisie
La double culture d’Erige Sehiri adoucit le regard qu’elle porte sur la France et la Tunisie, dans une sorte « d’entre deux intéressant à explorer » : « J’éprouve un sentiment d’affection ou de nostalgie pour quelque chose que je n’ai pas vécu dans chacun de ces deux territoires. »
« Les révolutions ont apporté une liberté d’expression soudaine, qui a permis de casser non seulement les clichés, mais aussi les tabous et, derrière la censure elle-même, l’autocensure. »
Dans ses films, elle cherche à montrer une autre Tunisie que celle des dépliants touristiques, celle de l’intérieur des terres, marginalisée, dans laquelle la parole (et en particulier celle des femmes) s’est libérée ces dernières années, mais où les blessures du passé, marqué par la dictature, affleurent en permanence et où « les frustrations de [citoyens] ultra connectés dans un monde globalisé [incitent] les jeunes à risquer leur vie pour traverser la Méditerranée ».
C’est aussi la Tunisie post révolutions arabes de 2011-2012 que l’on découvre dans le cinéma d’Erige Sehiri : « Pendant les années de dictature, ils ne pouvaient pas raconter ce qu’ils souhaitaient. Les révolutions ont apporté une liberté d’expression soudaine, qui a permis de casser non seulement les clichés, mais aussi les tabous et, derrière la censure elle-même, l’autocensure ».
Un cinéma engagé
La petite Erige a grandi dans un quartier d’où est partie la Marche pour l’Egalité, première manifestation antiraciste française en 1983, ce qui a forgé sa vision profondément sociale et politique du monde, qui imprègnera tous ses projets, qui porteront sur la jeunesse, la question de l’identité, du racisme ou des femmes.
« Mon parcours a été jalonné par les engagements. Parmi ceux-là, la révolution tunisienne a constitué un événement très important dans ma vie et pour la suite de mon travail : le pays de mes parents était en train de vivre quelque chose de grand et de formidable : une transition vers la démocratie ».
Avant 2011, son métier de journalisme constitue déjà une première forme d’engagement : elle rejoint un média alternatif d’opposition au pouvoir, « Nawaat », qui luttait contre la censure du régime Ben Ali, avant de fonder en 2014 « Inkyfada », un média d’investigation nécessaire dans un pays qui passe de la dictature à la démocratie », et de créer un projet de webradio avec des jeunes, pour leur apprendre les règles du journalisme « puisque la propagande du régime avait toujours été très présente ».
Et ce travail au long cours avec ces étudiants lui dévoile enfin l’une des clés de son avenir : « j’ai réalisé que c’est par le documentaire que j’avais envie de raconter ce qui se passait, car il permet d’accéder à une profondeur que le journalisme n’offre pas ».
Visions Sociales, à la Napoule… et en ligne !
En parallèle du festival Visions Sociales, qui se déroule du 17 au 24 mai dans les Alpes-Maritimes, la Médiathèque vous offre en exclusivité une sélection de films en accès libre, à voir avant et durant le festival.
Réservez vos soirées cinéma, certains ne sont visibles que durant 48 heures !
Et pour patienter, la Médiathèque vous propose une rétrospective de films projetés lors des éditions précédentes, en accès libre durant tout le mois de mai.
Voir la rétrospective sur la Médiathèque Voir les films projetés au festival (du 17 au 24 mai)
Tags: Article phare Cinéma Visions sociales