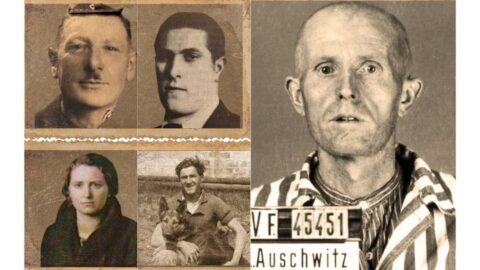Une Citroën traction avant, tour à tour voiture de la Gestapo et icône de la Résistance. Sur le bas-côté, un véhicule électrique Faure, né sous l’Occupation (Paris, février 1941). ©LAPI/Roger-Viollet
Deuxième épisode de notre chronique sur l’histoire du véhicule électrique : de la Belle Époque aux années 1930, l’électrique reste un marché de niche, jusqu’à son interdiction par l’armée d’occupation nazie en juillet 1942.
S’ils passionnent les foules, comme aujourd’hui les courses de formules 1, les records de vitesse engrangés par les voitures électriques au tournant du XXe siècle n’ont guère d’influence sur le développement du marché de l’automobile. Pour l’aristocratie et la bourgeoisie fortunée qui en sont les premiers clients, la voiture est un instrument de liberté, au service du développement du tourisme. Or, sur longue distance, le moteur thermique reste de très loin supérieur. C’est ce qui explique que, de la Belle Époque aux années 1930, qui voient l’automobile se développer massivement en France, la voiture électrique individuelle ait quasiment disparu.
Un marché de niche
Lorsque éclate la Première Guerre mondiale, 45 000 véhicules à moteur à essence sortent chaque année des chaînes des usines de l’industrie automobile française, alors de loin la plus puissante d’Europe. Les ingénieurs pionniers de l’électrique, comme Charles Jeantaud et Louis Krieger, se reconvertissent dans les modèles thermiques à essence, ou à diesel – une technologie inventée en 1897 en Allemagne, qui permet de multiplier la puissance – pour les camions.
Lire aussi
Épisode 1 : le temps des pionniers
La traction électrique devient un marché de niche, réservé à des flottilles de véhicules utilitaires urbains : chariots des halles centrales ou des paveurs de rue à Paris ; bus reliant la gare des Brotteaux à celle de Perrache à Lyon ; trolleybus à Rouen ou jusqu’à Modane, en Savoie ; véhicules de livraison du lait à Nancy ; tricycles pour la promenade au bois de Vincennes ; camionnettes du service postal parisien ou encore bennes à ordures, qui équipent à la veille de la Seconde Guerre mondiale 32 villes françaises.

Le 16 octobre 1904, le service des postes inaugure sa nouvelle flotte de douze véhicules entièrement électriques. Le premier véhicule de la Poste motorisée, acquis trois ans plus tôt, l’était aussi. Source : ©gallica.bnf.fr/BNF
Autant d’usages restreints, qui permettent cependant de maintenir une certaine compétence technique en matière de construction de véhicules à traction électrique. Tout le monde s’accorde alors à constater le triomphe du moteur à essence pour les voitures individuelles, et la relégation de l’électrique dans des micro-usages. La septième édition du Rallye de l’Automobile Club de France, en 1933, aligne bien quelques véhicules électriques… mais dans les catégories peu prestigieuses des camions à ordures, autobus, véhicules de livraison et chariots d’usine.
De pénuries en interdiction
Les pénuries, en particulier de carburant, qui affectent la France à partir de la déclaration de guerre de 1939, et plus encore avec l’occupation allemande, semblent offrir une nouvelle chance à la voiture électrique. Faute de pétrole, on lance des véhicules au gazogène, à l’alcool, à l’acétylène… et à nouveau à l’électricité, qui ne fait pas encore défaut, car les grands barrages hydroélectriques du sud de la France, construits dans l’entre-deux-guerres, sont en pleine activité. En mars 1941, Peugeot, qui s’était retiré du marché de l’électrique, lance sa 202 (aussi appelée VLV : voiturette légère de ville), qui annonce une autonomie de 80 km pour une vitesse maximale de 32 km/h. Ces performances pour le moins modestes, à peine supérieures à celles d’un cycliste bien entraîné, ne convainquent guère : la firme sochalienne n’écoule que 361 exemplaires de sa VLV durant l’Occupation… ce qui en fait pourtant le modèle le plus vendu !

Version familiale de la 202, cette Peugeot 402B équipée d’un système à gazogène consommait de 20 à 30 kg de charbon de bois à l’heure, avec une faible autonomie. Photo : Charles01/Wikimedia Commons – CC-BY-SA-3.0
Mais l’intensification des pénuries – notamment d’aluminium, métal léger, que l’on commence alors à employer pour la carrosserie des véhicules électriques, du cuivre et du plomb très utilisés pour le bobinage des dynamos et la fabrication des batteries – et les coupures d’électricité à répétition mettent vite fin à ce timide regain d’intérêt. Sur ordre du commandement militaire allemand en France, la production de voitures électriques est interdite par un arrêté en date du 10 juillet 1942.
À suivre…
Épisode 3
Le faux départ des années 1970