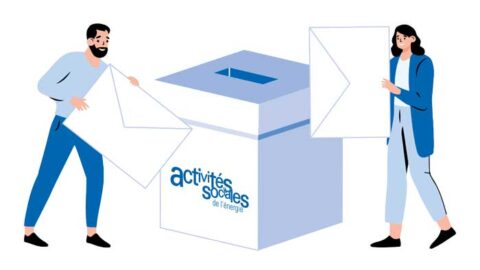Des ouvrières au travail dans une usine textile qui exporte en Europe, à Huaibei, à l’est de la Chine. ©Frame China/Shutterstock
Depuis juin 2014, Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT, siège à l’Organisation internationale du travail, où il mesure l’ampleur du chemin à parcourir pour plus de progrès social dans le monde, alors que, notamment en Europe, des reculs se font sentir.
Quelles sont les principales carences en matière de droit social à l’échelon mondial ?
La tendance globale est à la dégradation des droits sociaux, particulièrement en ce qui concerne la précarité des travailleurs. Ainsi dans le monde, six travailleurs sur dix exercent leur activité sans contrat de travail et ce phénomène lié à l’économie informelle progresse. 74 % de la population mondiale n’a pas de véritable système de protection sociale. Un travailleur sur deux n’a pas de retraite, et seuls 12 % des travailleurs touchent des allocations quand ils subissent une période de chômage (contre 40 % en France). Seulement 28 % des femmes bénéficient de congés maternité. On a recensé 168 millions d’enfants qui travaillent alors que c’est formellement interdit par la Convention internationale des droits de l’enfant. Et encore, c’est le chiffre officiel, et si l’on prend en compte la vingtaine de pays qui ne fournissent pas de chiffres sur le travail des enfants, on peut estimer qu’ils sont à peu près 200 millions…
On compte encore 40 millions de personnes recensées comme esclaves dans le monde.
Il y a chaque année 2,3 millions de personnes qui décèdent par accident du travail ou de maladie professionnelle, soit plus de morts du fait du travail que du fait de toutes les guerres réunies… Or les médias relayent peu ces morts au travail, sauf quand il y a de grosses catastrophes, comme lors de l’effondrement du Rana Plaza, au Bangladesh, qui a fait plusieurs milliers de victimes en une fraction de seconde.
Quid du droit syndical ?
La moitié de la population mondiale vit dans des pays qui ne reconnaissent pas le droit syndical, la négociation collective et le droit de grève. On peut citer les États-Unis, la Chine, les États du golfe et l’Inde, soit les principaux protagonistes des échanges mondiaux. Donc lorsque l’on parle de compétitivité des travailleurs au niveau mondial, on compare des choses qui ne sont pas comparables.
Les graves carences en matière de droits sociaux ne concernent-elles que les pays dits « en développement » ou les dictatures ?
Pas forcément, notamment en ce qui concerne le droit syndical : aux États-Unis, pays qui se pose en parangon de la démocratie, il faut, pour avoir une section syndicale dans une entreprise, passer par un référendum d’entreprise qui doit réunir 50 % des personnels. Si ce n’est pas le cas, il ne peut y avoir aucune représentation syndicale… C’est un processus contraire au droit à la négociation collective. Il faut savoir aussi qu’aux États-Unis seuls les salariés syndiqués pourront bénéficier des avancées négociées par leurs représentants. En France, au contraire, les syndicats négocient pour l’ensemble des travailleurs, syndiqués ou non, ce qui fait une grosse différence en termes d’avancées collectives.
Qu’est-ce que l’Organisation internationale du travail (OIT) ?
L’OIT a été fondée en 1919, à la suite de la Première Guerre mondiale, pour « poursuivre une vision basée sur le principe qu’il ne saurait y avoir une paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs ». Ce constat d’après-guerre qui lie la paix et la justice sociale est toujours d’actualité : le principe « à travail égal, salaire égal », c’est-à-dire la non-discrimination entre les travailleurs, reste le socle de notre organisation.
En 1946, l’OIT devient la première agence spécialisée de l’ONU, après avoir redéfini ses objectifs dans la déclaration de Philadelphie de 1944, qui avait relancé politiquement l’institution. Ce texte reste très moderne dans les valeurs qu’il porte. Il y est notamment dit que « le travail n’est pas une marchandise », ce qui sous-entend que le travailleur n’en est pas une non plus ! Que « la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous » : cette phrase résulte des enseignements de la crise économique de 1929, qui provoqua son cortège de précarité et de chômage en Europe, alors qu’aucune protection sociale n’existait alors. C’est d’ailleurs la misère qui gangrenait la société à l’époque qui a été le terreau des idées xénophobes du nazisme, à l’origine de la Seconde Guerre mondiale.
« Il faut consacrer la primauté des aspects humains et sociaux sur les considérations économiques et financières. »
Autre aspect de la déclaration de Philadelphie, qui va à l’encontre de ce que les gouvernements essaient de promouvoir depuis des décennies : « Il faut consacrer la primauté des aspects humains et sociaux sur les considérations économiques et financières. » C’est sur cette base que le Conseil national de la Résistance invente la Sécurité sociale, par exemple, affirmant que les principes sociaux priment sur les moyens pour les financer.
Toujours est-il que l’OIT, pourtant bientôt centenaire, est une institution qui reste méconnue du grand public. Elle a pour vocation d’élaborer des normes internationales sur la rémunération, sur le temps de travail… On en compte 189 aujourd’hui, qui ont le statut de traité international. Mais ces normes ne sont mises en œuvre dans les pays que si les États le décident, sauf pour huit normes fondamentales qui touchent les droits humains (travail des enfants, travail forcé, esclavage…) et qui, en principe, sont d’application universelle et n’ont pas besoin d’être ratifiées au préalable pour s’imposer.
Quels sont les moyens d’action de l’OIT, notamment par rapport à d’autres institutions internationales comme l’OMC ?
L’OIT est la seule institution mondiale où les travailleurs ont un pouvoir de vote équivalent à celui des employeurs. L’OIT a ensuite un pouvoir de contrôle de l’application des normes, qui est bien entendu plus efficace dans les pays qui ont décidé de ratifier ses textes. Il est également possible de déposer une plainte auprès de l’OIT. Un pays peut même déposer plainte contre un autre pays. Mais, dans 90 % des cas, ce sont des organisations de travailleurs qui déposent plainte contre un État parce qu’elles estiment qu’il ne respecte pas, sur son territoire, les règles de l’OIT qu’il a ratifiées.
S’agissant du social, les normes élaborées par l’OIT reposent sur la seule volonté des États.
Pour les règles économiques, celles de l’OMC, il y a un organisme chargé d’appliquer des sanctions financières qui peuvent être très lourdes. S’agissant du social, les normes élaborées par l’OIT reposent sur la seule volonté des États. Suite à une plainte, le conseil de l’OIT livre un avis et des recommandations, par exemple de mettre en place une loi contre le travail des enfants dans le pays concerné. Hélas, très souvent, ces recommandations ne sont pas suivies d’effets. Il faudrait renforcer les prérogatives de l’OIT et intégrer le respect des normes sociales dans les règles du commerce mondial. Autre incohérence : le FMI se permet, dans les contreparties demandées à ses prêts, d’exiger certaines mesures qui sont en infraction avec les règles de l’OIT. On peut citer le cas de la Grèce, à qui le FMI a demandé de diminuer le niveau des retraites.
Quid de l’Europe ?
En matière sociale, le droit européen est parfois inférieur aux normes internationales. Ainsi, la France a ratifié 138 normes sur les 189, donc il existe encore en France des carences concernant le travail domestique, la santé et la sécurité au travail, les travailleurs migrants… Il y a des pressions de l’Europe pour que les États membres ne ratifient pas certaines normes de l’OIT : c’est particulièrement le cas en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants. Paradoxalement, c’est en Europe que les droits sociaux sont les plus élaborés, grâce aux luttes passées, mais le vieux continent produit de moins en moins d’avancées sociales. Sous la pression des nationalismes et des politiques néolibérales, on assiste même à des reculs importants.
Les États sont-ils l’échelon pertinent pour le droit social ?
On constate un recul de la capacité des États à faire respecter des décisions internationales de l’OIT ou même de l’ONU. Les rapports de force bilatéraux sont en train de reprendre le pas sur ces décisions. L’attitude actuelle des États-Unis en est la parfaite illustration. Cette situation est particulièrement dangereuse.
Que pensez-vous des accords signés par de grandes entreprises transnationales, comme l’accord RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) du groupe EDF, conclu en mai 2018 ?
Aujourd’hui, ce sont moins les États qui pèsent pour faire évoluer le droit social que les 80 000 multinationales qui fournissent directement ou indirectement un emploi sur cinq dans le monde. Ces firmes ont une « réputation » à défendre vis-à-vis de leurs salariés et des consommateurs. C’est un des leviers qui peut faire bouger significativement leur comportement en matière sociale.
Quant aux RSE, ils sont principalement issus de grands groupes dont les sièges sont en Europe et donc soumis à la pression syndicale. Il faut surtout trouver les moyens de vérifier que cet accord sera appliqué sur le terrain. C’est prévu dans la RSE d’EDF [qui concerne 160 000 salariés, ndlr], et c’est une bonne chose. Mais les droits sociaux fondamentaux, comme la retraite ou la couverture maladie, ne devraient pas être dépendants de l’identité d’un employeur ; c’est un risque de discrimination qui existe avec ce genre d’accords. Il faut que les syndicats les prennent comme point d’appui, pour exiger la généralisation de ces nouveaux droits dans le cadre législatif national.
Pour aller plus loin
« La troisième guerre mondiale est sociale »
éditions de l’Atelier, 2016, 224 p., 15 euros (version numérique : 9, 99 euros).
Tags: À la une Europe Mouvement social Syndicats Travail